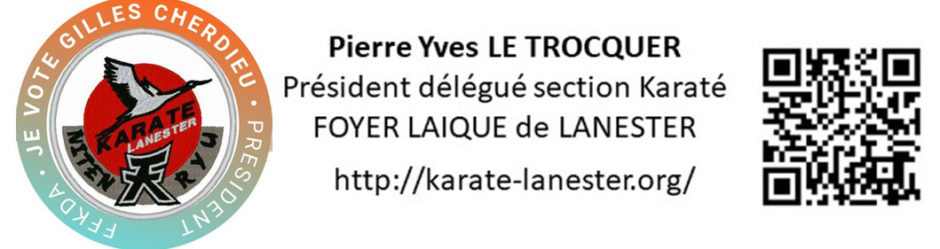ARTICLE PARU SUR LE SITE FFKDA le 11 FEVRIER 2022.
Initiateur du karaté uechi-ryu en France, Yukinobu Shimabukuro évoque pour nous sa longue expérience de l’entraînement, identifiant les points essentiels de l’apprentissage comme le secret de la longévité. Voyage immobile au cœur d’une éducation philosophique qui passe par le corps.
Parlez-nous du karaté de votre jeunesse…
À l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, ni de téléphone, ni même de télévision. Il y avait, au centre de nos villages, une place ou un jardin où nous nous retrouvions. Il n’y avait que ça à faire ! Vous, en Europe, c’était le foot, nous c’était le karaté. Il y avait toujours quelqu’un pour montrer un kata, une technique et on faisait beaucoup de makiwara dans le jardin. Ce n’est plus la même chose aujourd’hui. Mais dans ma jeunesse, il y avait, comme chez vous avec le ballon, des jeunes qui étaient déjà entraînés et plus forts que les autres, des adultes toujours prêts à faire avec nous, à conseiller ou à montrer. On faisait aussi du sumo tous ensemble, et du bo aussi. Moi je n’étais pas très bon à ce moment-là parce que j’étais petit. C’est pour ça que j’ai fait du kendo au lycée, parce qu’on disait que, avec les sauts, les poussées vers l’avant, ça faisait grandir. Je ne sais pas si j’ai grandi grâce au kendo, mais j’ai beaucoup aimé et ça m’a donné d’excellentes bases. En même temps, je savais que j’allais faire du karaté et devenir fort. J’ai pratiqué à l’université à Okinawa, avec Seiko Toyama, élève direct du fondateur du uechi-ryu, Kambun Uechi. Ce style était plutôt moderne dans les années 1960, à base de combat libre, beaucoup de durcissement et une partie de « combat total ». D’ailleurs, je faisais aussi du judo pour renforcer mon karaté et du motobu udundi, une sorte d’aïkido martial.
Quelle était l’ambiance de l’entraînement à l’université ?
On allait au « karaté club » et chaque style s’entraînait dans son coin au début. Ils n’étaient pas très amicaux les uns avec les autres. En quatrième année, je suis devenu président du club et j’ai changé ça. On s’est échauffé ensemble et on finissait par les combats souples en commun. À l’université, l’entraînement, c’était trois fois par semaine, mais moi j’habitais à trois kilomètres du dojo privé de mon professeur, et comme on finissait tôt, j’y étais tous les jours. Là-bas, c’était plutôt dur. Les anciens n’avaient pas peur de se blesser… ni de te blesser. Certains avaient un caractère fort ! Nous en faisions plus que les autres dans l’esprit du combat réel, il y avait aussi le kyokushin qui démarrait à l’époque… On faisait beaucoup de durcissement des bras, des tibias, du ventre. C’est une forme spécifique de musculation. Il y avait toujours le risque d’être frappé, le corps se renforce et réagit de façon réflexe. La première question posée par ce type d’entraînement était : ton corps est-il forgé pour l’épreuve ?
On a décrié ces formes dures d’entraînement. Avec votre expérience, qu’en pensez-vous ? Vous avez atteint les quatre-vingts ans en janvier de cette année. Gardez-vous des séquelles de cette période ?
Personnellement, je peux dire que cela a été bon pour moi. C’est une formation physique dont j’ai pu mesurer la valeur en arrivant en France. Les élèves étaient costauds, mais la différence était étonnante. Et pour le moment, je n’ai pas de problèmes d’arthrose dans les mains. Nous, on frappait tous les jours, mais en France, j’ai arrêté d’en faire autant. Aujourd’hui si je frappe trop, j’ai des douleurs aux poignets. Mais ça, c’est peut-être la vieillesse ! J’ai fait nettoyer mes genoux il y a dix ans et ça va plutôt bien. Je commence à avoir mal au dos… Vieillir, ça fait mal, mais l’entraînement fait du bien. Higaonna sensei est plus vieux que moi et il fait du makiwara tous les jours. Et quand je vois Mochizuki sensei qui pratique encore à quatre-vingt-cinq ans, je me dis que je peux continuer comme ça encore au moins cinq-six ans ! À partir de cinquante ans, c’est le corps qui compte. On perd le muscle de plus en plus vite, on commence à cesser l’exercice alors qu’on en a de plus en plus besoin. Il faut être de plus en plus vigilant. Faire attention à ce que l’on mange et à ce que l’on boit aussi. Quand je participe aux jurys de grade et que je vois les candidats trop gros, je sais qu’ils n’ont n’a pas su maintenir leur implication. C’est la régularité qui est la clé de l’entraînement. Pour répondre à la question, je dirais que le type de karaté que j’ai appris dans ma jeunesse m’a d’abord apporté ça : la santé, la solidité du corps. Funakoshi sensei a dit « Karate no shugyo wa issho de aru », il ne faut jamais cesser d’apprendre, jamais cesser de pratiquer. Alors c’est ce que je fais.
Comment envisagez-vous cette pratique quotidienne ?
Grâce au karaté, je freine mon vieillissement. Physiquement, je suis bien. Bien sûr, quand l’âge avance, on fait moins de durcissement. Et pas de combat libre non plus ! Je ne pratique plus avec les élèves. C’est dommage, mais je dois être attentif aux risques de blessure. Cela devient difficile de guérir. Alors c’est l’échauffement, les techniques de base, kihon et kata. J’enseigne encore six fois par semaine et, de ce point de vue, il n’y a pas de grande différence. La difficulté, en avançant dans les années, c’est que l’on perd un peu de force mentale. On est moins désireux de sortir, on aime rester chez soi. Parfois, il faut que je m’encourage ! Mais j’aime toujours transmettre, j’aime l’entraînement, j’aime voir les progrès de mes élèves à travers les années. Je ne suis pas déprimé, grâce au karaté. Et il m’offre encore des défis : il y a trois ans, avant toute cette période, j’ai participé à une compétition de kata à Okinawa. J’étais le plus vieux de la catégorie des plus de soixante-dix ans, j’ai fini quatrième sur une quinzaine de participants, c’était une belle aventure.
Vous avez consacré votre vie au karaté, et au uechi-ryu. Êtes-vous satisfait de ce choix ?
Les choses se sont enchaînées et on ne choisit pas tout. En 1960 je crois, j’ai été invité en Martinique et j’ai rencontré ma femme, institutrice dans le Pas de Calais. Nous avons vécu en France, puis quelques années au Japon, nous sommes revenus. C’était ma mission de diffuser ici ce que j’avais appris. Si je regarde le passé avec mon œil d’aujourd’hui… je me dis que j’aurais dû être un médecin sans frontière par exemple. Mais avec ma mentalité de jeune homme… je referai tout pareil ! Et le karaté a été une très bonne chose dans la vie de l’homme que je suis. Il m’a aussi permis d’aider, d’éduquer des générations. D’ailleurs, je continue à dire aux gens de faire du karaté, de le recommander à tous. Cette foi en ma discipline ne m’a jamais quitté. On entre dans le karaté par les techniques de défense personnelle, mais ce que je comprends, c’est qu’il s’agit d’une éducation philosophique. Nous y devenons des adultes solides mentalement et physiquement, utiles à la société. C’est l’essentiel.
Quel serait le meilleur conseil que vous puissiez donner à un jeune pratiquant ?
Il y en aurait beaucoup, mais ce qui me paraît important c’est de corriger immédiatement l’erreur que le professeur vous signale. Il faut intégrer tout de suite et entrer dans un processus personnel pour ne pas faire deux fois la même faute. À Okinawa, et au Japon en général, c’est une culture. On travaille beaucoup individuellement, sans direction du professeur. Si on propose ça en France, les élèves discutent. C’est le tempérament général. Ici, on ne travaille pas seul. En karaté, c’est un modèle que l’on emploie pour les étudiants débutants, les militaires. Pour certains, j’ai l’impression de toujours leur répéter la même chose. Au bout d’un moment, le professeur lui aussi laisse tomber. Les Japonais savent toujours ce qu’ils ont à faire en fonction des situations. À l’entraînement, il faut s’entraîner. Pour les Français, ce n’est pas si clair… Ils ont tellement la passion de l’échange.
Que pensez-vous des Français et de la France ?
En France, et en Europe en général, il y a beaucoup de gentillesse et une maturité humaine forte, sans doute supérieure à ce que l’on trouve au Japon. La contrepartie est une forme d’individualisme qui confine parfois à l’égoïsme. Les Français ont de grandes considérations pour les droits de l’homme, mais pas toujours pour leurs voisins. Et ils font n’importe quoi dans les parkings, quand il s’agit de garer les voitures. C’est déroutant pour un Japonais. De même que cette vision très égalitariste du monde. D’où je viens, la hiérarchie est forte. On doit montrer tous les signes du profond respect qui est dû au professeur. Ici, ce n’est pas vraiment le cas. Les élèves vous considèrent comme un ami. Certains donnent leur avis sur la technique que l’on étudie ! Pour certains de mes compatriotes, c’est difficile à accepter. À Okinawa, on est plus égalitaire qu’à Tokyo et avec l’habitude, cela devient agréable de vivre de cette façon, d’autant que je sais qu’il y a tout de même du respect. Et la France est un pays parfait où l’on mange très bien, notamment le porc, dont les Okinawaïens raffolent. Avec les progrès technologiques, je suis moins coupé de mes racines. J’ai ce qu’il faut pour rester ici en espérant, pour moi comme pour les autres, une vie tranquille et heureuse. J’ai un petit bout de jardin pour pratiquer le karaté, c’est suffisant.